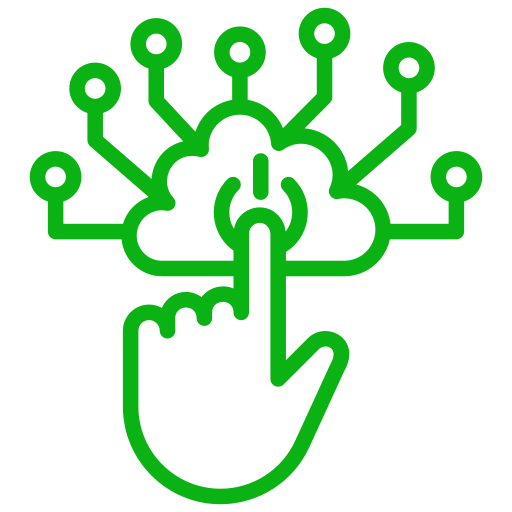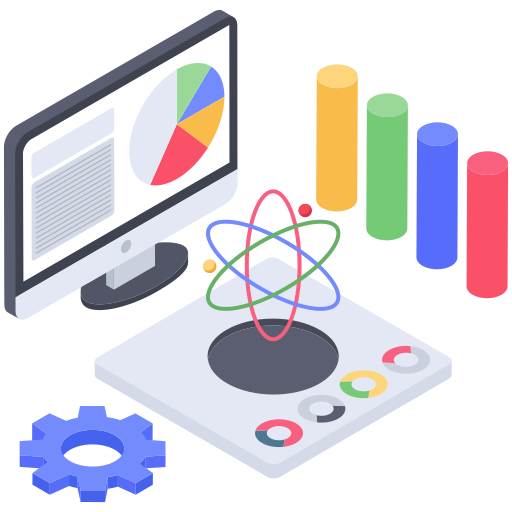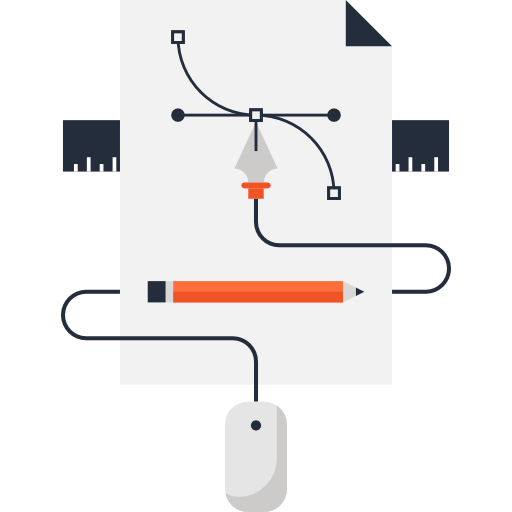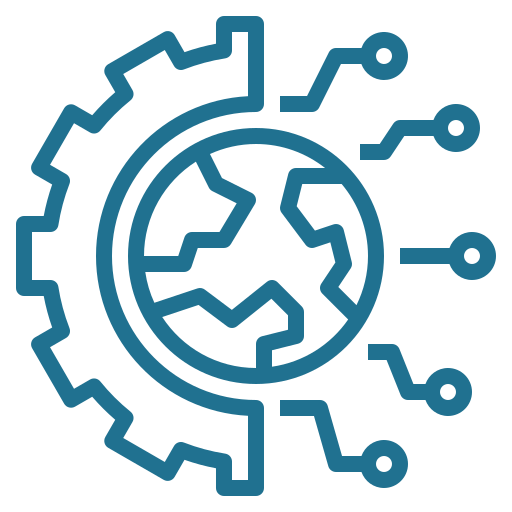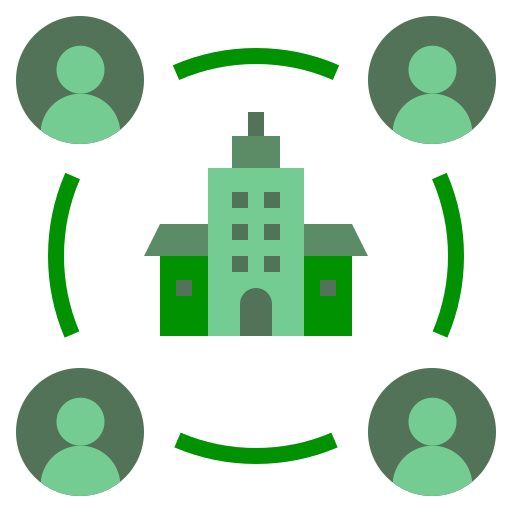Sommations finies
Indices
On rappel que pour tout \( a\leqslant b\) , on note \( \intEFF{a}{b}\) l'intervalle des nombres entiers entre \( a\) et \( b\) . Comme pour les nombres réels on adoptera les notations de bornes incluses ou non (\( \intEFO{a}{b}\) , \( \intEOF{a}{b}\) et \( \intEOO{a}{b}\) )
On rappel qu'une bijection de \( E\) sur \( F\) est la donnée d'une application \( \varphi : E\rightarrow F\) tel qu'il existe \( \psi : F\rightarrow E\) tel que pour
- \( (i)\) .
- \( \forall e\in E\) , \( \psi(\varphi(e))=e\) .
- \( (ii)\) .
- \( \forall f\in F\) , \( \varphi(\psi(f))=f\) .
On dit que \( \psi\) est la
bijection réciproque.
Définition
Un sous-ensemble d'un référentiel quelconque qui peut être mis en bijection avec un sous-ensemble de \( \Z\) est un ensemble d'indice
Par exemple \( \{-1 ; 7; 9\}\) est un ensemble d'indice. Dans la pratique les ensembles d'indices sont les sous-ensembles de \( \Z\) de la forme \( \intEFF{a}{b}\) ou \( \intEFO{a}{b}\) lorsque \( b=+\infty\) .
Lemme
L'ensemble des entiers naturel \( \N\) est un ensemble d'indice.
Démonstration
On montre que les deux applications suivantes sont des bijections réciproques l'une de l'autre :
\begin{eqnarray*}
\varphi : \N&\longrightarrow&\Z\\
n&\longmapsto&\left\{
\begin{array}{ll}
-\dfrac{n}{2}, &\text{si \( n\) est paire}\\
\dfrac{n+1}{2}, &\text{sinon}
\end{array}
\right.
\end{eqnarray*}
\begin{eqnarray*}
\psi : \Z&\longrightarrow&\N\\
x&\longmapsto&\left\{
\begin{array}{ll}
-2x, &\text{si \( x\leqslant 0\) }\\
2x-1, &\text{sinon}
\end{array}
\right.
\end{eqnarray*}
Proposition
L'union, l'intersection, le complémentaire et le produit cartésien (fini) d'ensembles d'indice est un ensemble d'indice.
Démonstration
L'union, l'intersection et le complémentaire de sous-ensembles de \( \Z\) est un sous-ensemble de \( \Z\) , ce qui permet de construire des bijections aisément pour arriver à la définition.
D'après le lemme précédent, il suffit de montrer que \( \N\times \N\) est un ensemble d'indice ce qui permettra de prouver que tout sous-ensemble de \( \N\times \N\) est un ensemble d'indice donc tout sous-ensemble de \( \Z\times \Z\) et
a fortiori les sous-ensembles de la forme \( I\times J\) . Pour cela on numérote les éléments de \( \N\times \N\) en diagonale ce qui permet d'associé à chaque point du réseau \( \N\times \N\) une valeur entière et réciproquement.
Définition
Soit \( I\) un ensemble d'indice. Une suite réelle \( u\) indexée par \( I\) est la donnée d'une application de \( I\) sur \( \R\) .
Pour tout \( i\in I\) on appel \( i\) -ème terme de \( u\) , noté \( u_i\) l'image de \( i\) par \( u\) .
En d'autre terme, à chaque indice on associe une valeur réelle.
Les suites indexées par \( \intEFO{0}{+\infty}\) sont les
suites numériques classiques.
Définition
Soit \( u\) une suite indexée par un ensemble d'indice \( I\) . On note
\[\sum_{i\in I}u_i\]
la sommation de tous les termes la suite \( u\) .
Par exemple si \( I=\intEFF{1}{3}\) et \( u=(2, -7, \pi)\) alors \( \dpl{\sum_{i\in I}u_i}=2+(-7)+\pi=-5+\pi\) .
Définition [Troncature]
Soient \( I\) un ensemble d'indice et \( J\subseteq I\) . On note \( u_{|J}\) la restriction de \( u\) à \( J\) .
\[\forall j\in J,\ u_{|J}(j)=u(j)\]
Pour ne pas alourdir les notations et lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté on notera simplement \( u\) la restriction de \( u\) à \( J\) .
Si par exemple \( I=\intEFF{0}{5}\) , \( u=(9, 6, 1, 0, 1, 7)\) et \( J=\{0; 2; 4\}\) alors \( u_{|J}=(9, 1, 1)\) .
Remarque
La variable de sommation est dite muette : elle n'intervient pas dans le résultat de la sommation mais dans sa formulation. Ainsi
\( \dpl{\sum_{i\in I}\alpha_i=\sum_{j\in I}\alpha_j=\sum_{k\in I}\alpha_k=\sum_{truc\in I}\alpha_{truc}}\) .
Propriétés de la sommation
A partir de maintenant et jusqu'à la fin du chapitre, les ensembles d'indices sont tous de cardinalité finie.
Proposition
Soient \( I\) et \( J\) des ensembles d'indices, \( \alpha\) une suite de nombres réelles indexées par \( I\cup J\) .
- \( (i)\) .
- Si \( I\cap J=\varnothing\) , \( \dpl{\sum_{k\in I\cup J}\alpha_k=\sum_{i\in I}\alpha_i+\sum_{j\in J}\alpha_j}\) .
- \( (ii)\) .
- \( \dpl{\sum_{k\in I\cup J}\alpha_k=\sum_{i\in I}\alpha_i+\sum_{j\in J}\alpha_j-\sum_{l\in I\cap J}\alpha_l}\) .
Démonstration
Notons \( I=\{i_1, \ldots, i_N\}\) et \( J=\{j_1,\ldots, j_M\}\) alors \( I\cup J=\{i_1, \ldots, i_N, j_1, \ldots, j_M\}\) dans ce cas
\[\sum_{k\in I\cup J}\alpha_k=\alpha_{i_1}+\cdots+\alpha_{i_N}+\alpha_{j_1}+\cdots+\alpha_{j_M}=\sum_{i\in I}\alpha_i+\sum_{j\in J}\alpha_j\]
Si \( I\cap J\neq \varnothing\) , notons \( I\cap J=\{k_1, \ldots, k_R\}\) alors
\( I=\{i_1, \ldots, i_N, k_1,\ldots, k_R\}\) et \( J=\{j_1,\ldots, j_M, k_1, \ldots, k_R\}\) . Nous avons alors :
\begin{eqnarray*}
\sum_{i\in I}\alpha_i+\sum_{j\in J}\alpha_j-\sum_{l\in I\cap J}\alpha_l&=&\left(\alpha_{i_1}+\cdots+\alpha_{i_N}+\alpha_{k_1}+\cdots+\alpha_{k_R}\right)\\
&&+
\left(\alpha_{j_1}+\cdots+\alpha_{j_M}+\alpha_{k_1}+\cdots+\alpha_{k_R}\right)\\
&&-\left(\alpha_{k_1}+\cdots+\alpha_{k_R}\right)\\
&=&\left(\alpha_{i_1}+\cdots+\alpha_{i_N}\right)+\left(\alpha_{j_1}+\cdots+\alpha_{j_M}\right)+\left(\alpha_{k_1}+\cdots+\alpha_{k_R}\right)\\
&=&\sum_{l\in I\cup J}\alpha_l
\end{eqnarray*}
Corollaire
Soit \( (\alpha_i)_{i\in I}\) une suite de nombres réelles indexées par un ensemble d'indice \( I\) .
\[\sum_{i\in \varnothing}\alpha_i=0\]
Démonstration
D'après le point \( (i)\) du précédent résultat nous avons :
\[\sum_{i\in I}\alpha_i=\sum_{i\in I\cup \varnothing}\alpha_i=\sum_{i\in I}\alpha_i+\sum_{i\in \varnothing}\alpha_i\]
d'où le résultat.
Théorème [Linéarité]
Soient \( I\) un ensemble d'indice, \( \alpha\) et \( \beta\) des suites de nombres réelles indexées par \( I\) et \( \lambda\in \R\) .
- \( (i)\) - Commutativité.
- \( \dpl{\sum_{i\in I}(\alpha_i+\beta_i)=\sum_{i\in I}\alpha_i+\sum_{i\in I}\beta_i}\) .
- \( (ii)\) - Distributivité.
- \( \dpl{\sum_{i\in I}\lambda\alpha_i=\lambda\sum_{i\in I}\alpha_i}\) .
Démonstration
Il s'agit d'un reformulation de la commutativité de l'addition (\( a+b=b+a\) ) et de la distributivité dans \( \R\) (\( \lambda(a+b)=\lambda a+\lambda b\) ).
Théorème [Fubini]
Soit \( \alpha\) une suite de nombre réelles indexées par un ensemble de la forme \( I\times J\) pour deux ensembles d'indices \( I\) et \( J\) .
- \( (iii)\) - Associativité.
- \( \dpl{\sum_{(i, j)\in I\times J}\alpha_{(i, j)}=\sum_{i\in I}\left(\sum_{j\in J}\alpha_{(i, j)}\right)
=\sum_{j\in J}\left(\sum_{i\in I}\alpha_{(i, j)}\right)}\) .
Démonstration
Il s'agit de la reformulation de l'associativité de la l'addition (\( (a+b)+c=a+(b+c)\) ).
Théorème [Changement de variable]
Soit \( \varphi:J\rightarrow I\) une bijection entre deux ensembles d'indices et \( \alpha\) une suite de nombres réelles indexées par \( I\) .
\[\dpl{\sum_{i\in I}\alpha_i}=\sum_{j\in J}\alpha_{\varphi(j)}\]
Démonstration
Numérotons les éléments de \( I\) et de \( J\) à l'aide de \( \varphi\) . Précisément, notons \( I=\left\{i_1, \ldots, i_N\right\}\) et \( J=\left\{j_1, \ldots, j_N\right\}\) (ils sont nécessairement de même cardinalité \( N\) car en bijection) de telle sorte que \( \varphi(j_k)=i_k\) . Alors
\begin{eqnarray*}
\sum_{j\in J}\alpha_{\varphi(j)}&=&
\alpha_{\varphi(j_1)}+\cdots+\alpha_{\varphi(j_N)}\\
&=&\alpha_{i_1}+\cdots+\alpha_{i_N}\\
&=&\sum_{i\in I} \alpha_i
\end{eqnarray*}
Corollaire [Formule du produit]
Soient \( \alpha\) et \( \beta\) deux suites de nombres réelles respectivement indexées par \( I\) et \( J\) des ensembles d'indices. Si \( i\not\in I\) on convient que \( \alpha_i=0\) . De même si \( j\not\in J\) , \( \beta_j=0\) .
- \( (iv).\)
- \( \dpl{\left(\sum_{i\in I}\alpha_{i}\right)\times\left(\sum_{j\in J}\beta_{j}\right)=\sum_{(i, j)\in I\times J}\gamma_{(i, j)}}\) où \( \gamma_{(i, j)}=\alpha_i\beta_j\) .
- \( (v)\) .
- Dans le cas où \( I=\intEFF{a}{n}\) et \( J=\intEFF{b}{m}\) pour des entiers \( a\leqslant n\) et \( b\leqslant m\) ,
\[\left(\sum_{i=a}^n\alpha_i\right)\times \left(\sum_{j=b}^m\beta_j\right)=\sum_{k=a+b}^{n+m}\gamma_k\]
où \( \dpl{\gamma_k=\sum_{i=a}^{k-b}\alpha_i\beta_{k-i}=\sum_{j=b}^{k-a}\alpha_{k-j}\beta_{j}}\) .
Démonstration
La première égalité est la réécriture de la somme. Seul le dernier point nécessite quelques détails. On a \( \intEFF{a}{n}\times\intEFF{b}{m}=X_{a+b}\cup X_{a+b+1}\cup X_{a+b+2}\cup\cdots X_{n+m}\) , où \( X_k=\{(i, j)\in \intEFF{a}{n}\times\intEFF{b}{m}| i+j=k\}\) . Naturellement si \( k\neq k'\) alors \( X_k\cap X_{k'}=\varnothing\) ; il ne peut, en effet, exister de couple \( (i,j)\) tel que \( i+j=k\) et \( i+j=k'\) lorsque \( k\neq k'\) . Ainsi :
\begin{eqnarray*}
\left(\sum_{i=a}^n\alpha_i\right)\times \left(\sum_{j=b}^m\beta_j\right)
&=&\sum_{(i, j)\in \intEFF{a}{n}\times\intEFF{b}{m}}\alpha_i\beta_j\\
&=&\sum_{(i, j)\in X_{a+b}}\alpha_i\beta_j+\sum_{(i, j)\in X_{a+b+1}}\alpha_i\beta_j+\cdots+\sum_{(i, j)\in X_{n+m}}\alpha_i\beta_j\\
&=&\sum_{k=a+b}^{n+m}\sum_{(i, j)\in X_{k}}\alpha_i\beta_j
\end{eqnarray*}
Or \( \varphi_k:\intEFF{a}{b-k}\rightarrow X_k\) , \( i\mapsto(i, k-i)\) est une bijection de sorte qu'en appliquant ce changement de variable on a \( \dpl{\sum_{(i, j)\in X_{k}}\alpha_i\beta_j=\sum_{i\in \intEFF{a}{b-k}}\alpha_i\beta_{k-i}}\) . De la même manière, la bijection \( \psi : \intEFF{b}{k-a}\rightarrow X_k\) prouve la seconde égalité.
Sommations classiques
Proposition
- Somme de Gauss.
- Soit \( n\in \N\) ,
\[\sum_{k=0}^nk=\dfrac{n(n+1)}{2}\]
- Somme quadratique de Gauss.
- Soit \( n\in \N\) ,
\[\sum_{k=0}^nk^2=\dfrac{n(n+1)(2n+1)}{6}\]
- Somme des termes d'une suite géométrique.
- Soient \( q\in \R-\{1\}\) et \( n\in \N\) , \[\sum_{k=0}^nq^k=\dfrac{1-q^{n+1}}{1-q}\]
- Binôme de Newton.
- Soient \( a\) et \( b\) des nombres réels et \( n\in \N\) .
\[(a+b)^n=\sum_{k=0}^nC_n^ka^kb^{n-k}\]
où \( C_n^k=\dfrac{n!}{k!(n-k)!}\) est le coefficient binomiale.
Démonstration
Ces résultats se démontrent par récurrence, ce que nous aborderons en TD.